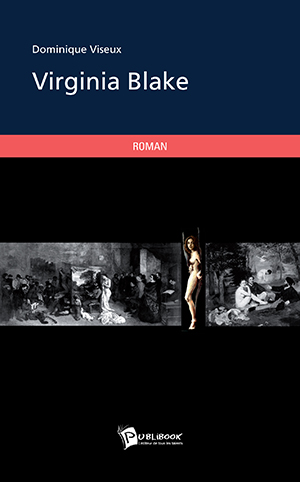
Virginia Blake
« L’amnésie suspecte d’une jeune artiste dans les milieux de l’art contemporain. Sa renaissance et sa rechute, avec en arrière-plan une trajectoire amoureuse, tenace et singulière. »
Dans un univers moderne mais curieusement « décalé » et qui prend des allures d’hypothèse, Virginia Blake – artiste très en vue, victime d’un accident – devient totalement amnésique ; recueillie par son compagnon supposé, un directeur très influent de galeries, elle part opiniâtrement sur les traces de ses relations anciennes pour redécouvrir enfin – auprès de Ludwig, journaliste contestataire – l’épisode passionnel qui l’a profondément modifiée.
Usant de l’amnésie comme argument majeur pour un regard neuf et vierge, le roman suit les errances de l’âme féminine dans sa découverte du monde, lequel apparaît peu à peu comme une grossière machinerie aux rouages bien huilés. Un monde sans âme et lui-même amnésique.
Genre Littéraire :
Fiction contemporaine
Éditeur :
Éditions Publibook, Paris
https://www.publibook.com
Parution : 2013
ISBN : 9782342015263
Format : 14 x 20 cm
Nombre de pages : 220
Version papier : 21 €
Version PDF : 10,50 €
Extrait
Il faut que je réapprenne le sens des mots et des situations. Si mon nom est véritablement Virginia Blake, il se peut que je ne l’aie jamais si bien porté qu’en cet instant où tout est neuf pour moi, où toute chose s’imprime en mon esprit avec une netteté saisissante parce qu’elle est dépouillée de signification. Je suis comme une feuille noire et vierge sur laquelle la moindre trace prend un relief inattendu.
Tout à l’heure, il m’a dit :
— C’est ici.
Les portières ont claqué et résonné longtemps dans cet espace sombre que je devinais immense quoique très bas de plafond, où se mêlaient des odeurs de gaz brûlés et de béton refroidi. Je l’ai suivi. Nous avons pris un ascenseur. Durant la montée, j’étais à l’écoute de chaque bruit pour me distraire d’une gêne qui m’était insoutenable. Il me regardait sans parler ; je baissais les yeux, fixant dans le miroir les boutons de mon imperméable pour éviter que mon regard ne rencontre le sien.
Sur le palier, il a glissé une carte et tapé un code ; poussant la porte, il m’a dit :
— C’est ici.
Nous nous sommes mis à l’aise. Tandis qu’il accrochait nos vêtements sur des cintres, au lieu d’explorer l’endroit je l’ai regardé faire. J’ai eu cette impression curieuse que c’était lui, maintenant, qui fuyait mes regards et qu’une chose non dite s’interposait entre nous, comme une suspicion mutuelle. Refermant le placard, après avoir enfilé des savates, il m’a dit :
— Voilà. C’est chez moi. Enfin… chez nous.
Puis il m’a contemplée longuement. Je n’ai su que répondre, n’affichant qu’un sourire emprunté. Il a ajouté :
— Chez toi, Ginie…
Ces derniers mots m’ont fait tressaillir. Sans doute s’en est-il aperçu, pour m’avoir adressé aussitôt une tape amicale sur l’épaule en reprenant sur le ton le plus ordinaire possible :
— Je vais me rafraîchir. J’en ai pour un quart d’heure. En attendant, fais donc le tour de l’appartement. Visite. Regarde un peu partout.
Disparaissant dans la salle de bains, il m’a lancé encore :
— Tu es chez toi, Ginie… Fais comme chez toi !
L’appartement est vaste et luxueux. Arrangé avec goût, me semble-t-il, encore que je n’ai pas une présence d’esprit suffisante pour en apprécier la décoration, ni pour pénétrer le sens et la fonction de multiples objets, affiches ou toiles exposés sur les murs, sur les tables de verre, sur la moquette même. J’effectue une rapide visite des lieux, laquelle – à vrai dire – ne me passionne pas. Un long couloir me mène jusqu’à un atelier qui débouche lui-même sur une sorte de gymnase. Je reviens au salon et, pour patienter, je refais l’inventaire de mon sac : quelques carnets de notes et de rendez-vous que je connais par cœur maintenant ; des objets usuels. Rien qui me rappelle quoi que ce soit de décisif.
En tenue légère, il apparaît à la porte du salon :
— Tu as faim ?
Je fais signe que j’ai un peu faim.
Nous mangeons. Ce n’est pas très bon, mais un rien suffit à me rassasier comme à me dégoûter. Durant notre face à face à la table de la cuisine, l’insurmontable gêne de l’ascenseur me reprend. Il me demande :
— Tu as pris tes cachets ?
— Oui, dis-je.
Je le sens à l’affût d’un prétexte pour parler et renouer avec moi des liens dont j’ignore tout.
— Alors, cet endroit ne te rappelle rien ?
— Excusez-moi, dis-je. Non. Vraiment rien.
— Ginie, reprend-il tout en mangeant, il faut me tutoyer. Et m’appeler Gérald. Tu le sais bien…
— Oui, je sais… Mais, comment expliquer ?.. Mettez-vous à ma place. Je n’ai pas l’impression de vous connaître. Enfin, je veux dire… que j’ai l’impression de ne pas vous connaître.
Je parle. Je parle, mais l’étrangeté des mots, des phrases que je prononce par une sorte de seconde nature, cette seule étrangeté résonne en moi. Des mots, des phrases, de leur sens, je ne distingue plus l’origine ou la fin.
— Bien sûr, bien sûr, je comprends. Mais tu n’as qu’à faire comme si tu me connaissais. Tu verras. Ça reviendra vite entre nous.
Il sourit et ajoute :
— Mets-toi aussi à ma place ! Tu crois que c’est drôle pour moi ?
Je n’ai pas envie de m’exercer à ce jeu. Pas même de le questionner sur le passé. En réalité, la situation que je vis présentement m’est à ce point dépourvue d’intérêt que je ne peux y prendre part. Il me semble que je rêve où que, par erreur, je viens de débarquer en pays étranger ; que je suis en attente, à un poste frontière.
Après le repas, nous quittons la cuisine pour rejoindre le salon, puis la chambre. Assis sur le lit, côte à côte, nous feuilletons des revues. Gérald me montre des photos, commente une récente exposition, me parle de choses qui me sont inconnues mais qui devraient – à ce qu’il prétend – m’être familières. Je ne l’écoute pas. Le lit sur lequel nous sommes installés, en vérité, m’obsède l’esprit ; et je me demande avec angoisse s’il me faudra bientôt le partager avec cet homme que je côtoie en cet instant sans que la raison m’en soit vraiment donnée. Cet homme que je soupçonne à présent de vouloir susciter de ma part une reddition accélérée. Après quelques temps de patients et louables efforts pour captiver mon intérêt, il s’aperçoit de ma distraction – de mon absence, devrais-je dire – et dépose ses revues pour prendre mon visage entre ses mains. Ce contact me laisse interdite.
— Ginie, ma petite Ginie, dit-il. Tu m’as manqué, tu sais.
Je n’aime pas ce surnom qu’il me donne et qui me fait penser à une marque d’alcool. J’aime moins encore qu’il me caresse les joues, les ailes du nez avec le plat de ses deux pouces, dans un mouvement symétrique, circulaire et rêveur, comme s’il buvait à petits coups un verre de Brandy. Ses lèvres plusieurs fois effleurent les miennes et ce baiser répété suffit à me causer une indicible angoisse. Mais je ne veux pas lutter. D’ailleurs en ai-je la force ? Pour quoi et contre quoi devrais-je lutter ? Cette situation en vaut une autre. Ouvrir une portière de voiture, prendre un ascenseur, manger des petits pois, me laisser caresser et bientôt étendre sur ce lit, tout m’est rigoureusement équivalent, indifférent. En quête d’arguments, ma raison n’embrasse que des régions vides ; tous mes repères se sont évanouis.
Il se lève et m’attire à lui. Alors, sans me regarder, la tête penchée sur mon épaule, avec des gestes sûrs et décidés, il me déshabille. Il me déboutonne, me dégrafe, m’épluche, m’ouvre, me met à nu. Je le laisse opérer, ne sachant que faire de mes mains, de mes gestes à moi, de ma respiration même ; je suis pareille à une infirme. Il tire sur ma culotte, me déchausse, lance mes vêtements un à un sur une chaise. Je songe qu’il pourrait tout aussi bien les laisser où ils tombent, par terre, sur la moquette. Ma propre passivité m’effraie et à la fois me sert d’asile. Enfin il ouvre le lit, et sans qu’il ait à envisager d’y allonger le corps qu’il vient de dénuder, j’en prends l’initiative. Il me sourit amicalement. Je le devine soulagé par mon esprit coopératif ; il se déshabille à son tour, très vite, comme s’il craignait que je puisse m’impatienter. C’est un homme bien en chair, dans la force de l’âge, velu sur les cuisses et le torse. Son sexe est impressionnant ; déjà il est dressé.
La lumière de la chambre, quoique indirecte, m’indispose. Le fait aussi qu’il néglige de ramener sur nous ne serait-ce qu’un drap. Mon malaise augmente dès qu’il s’empresse auprès de moi, palpe mes seins ou tente d’exciter mon sexe qui demeure insensible. Avec difficulté, il m’écarte et me pénètre, ce qui m’est douloureux. Lentement alors il s’ébranle ; durant de longues minutes, son rythme ne variera pas.
Je ne sais qu’ajouter à cela. Je ne connais durant l’étreinte ni sentiment ni émotion d’aucune sorte. Un instant, j’avais craint de sa part quelque démonstration préalable de tendresse à laquelle il m’eût fallu répondre, de trop longues caresses, des murmures amoureux, une exigence de réciprocité en somme. Mais rien. Rien, heureusement. Nous sommes allés tout droit au fait et il m’est à peine nécessaire de soupirer ou de feindre quoi que ce soit. Il est tout à son œuvre, couché sur moi, mouvant sur moi ; mais c’est en lui qu’il se meut, même si c’est en moi qu’il jouit. Ce dernier point est secondaire. Je me rends compte de son absence, de ma seule présence en ce moment, sur ce lit, sous son corps, ailleurs et nulle part à la fois.
L’humidité soudaine de nos sexes m’indique qu’il achève de jouir. Son mouvement se poursuit mais décélère peu à peu. Il se retire. Je me referme. En allongeant le bras, il éteint la lumière puis ramène le drap ; alors il me caresse la joue et demande :
— Ça va ?
— Ça va, dis-je.
Il fait nuit noire dans la chambre. Le cadran d’un réveil jette une lueur verte, pareille à un halo, irréelle. A mes côtés, couché sur le dos, Gérald déjà ronfle doucement tandis que sa semence continue de s’écouler avec lenteur hors de moi. La régularité de sa respiration m’apaise et m’obsède à la fois. Je voudrais profiter de cet instant pour rassembler mes pensées, mais la pensée me fuit. Je voudrais m’endormir ; le sommeil ne vient pas. Longtemps je reste là, étendue, les yeux ouverts dans le noir de la nuit, sans bouger, l’âme vide. Le déclic des minutes sur le cadran verdâtre, entre les ronflements légers, jalonne sans déroger un temps qui me semble infini.
Je rêve que je cours dans le noir. Je rêve que je suis ivre, et que je cours dans la nuit.