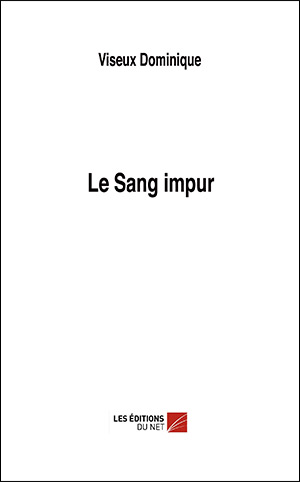
Le Sang impur
Incarcérée à la prison de la Force, sous la Terreur, Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, dévide de mémoire le déroulement de sa vie. Amie intime de la reine Marie-Antoinette, sujette à l’épilepsie, contaminée par le « mal de Naples » par le biais de son mari débauché et défunt, elle reconstruit sa vie loin de la cour de Versailles, traverse les milieux occultistes et la franc-maçonnerie – et un odieux chantage aussi – pour rencontrer enfin le médecin allemand Seiffert qui lui rendra le goût de vivre. Mais l’histoire la rattrape à l’heure de la révolution ; sa fidélité à la reine, un déluge de calomnies savamment orchestrées, la menace aux frontières, l’enferment peu à peu dans une nasse mortelle.
Genre Littéraire :
Roman historique
Éditeur :
Les Éditions du Net
https://www.leseditionsdunet.com
Parution : 2013
ISBN : 978-2-312-01452-4
Format : 15 x 23 cm
Nombre de pages : 190
Version papier : 13 €
Version PDF: 9,10 €
Extrait
Des bruits assourdissants de grilles et de portes claquées viennent de la sortir de son évanouissement. Ses yeux s’ouvrent. Le cauchemar demeure ; de quelque côté qu’elle passe à présent, il est là devant elle, autour d’elle et en elle. Le rêve et la veille se confondent ; images et souvenirs font ensemble une mauvaise farandole qui n’a plus de la vie que son tourbillonnement.
Deux mains féminines lui tiennent les tempes, épongent d’un mouchoir la sueur qui perle sur son front. Les journées d’août sont épuisantes et la chaleur fait suinter les murs sombres qu’on devine verdâtres, de ce vert terreux des côtes d’Angleterre quand elles ruissellent sous la pluie. Thérèse fouille l’ombre d’un regard fiévreux pour voir où il se cache ; elle le découvre dans l’angle de la porte et du mur ; il est là, toujours là, qui la guette et l’attend. Elle en perçoit les reflets bleus, la carapace marbrée de jaune, les yeux dont les lueurs dégagent cette patience cruelle qui est le propre des bêtes silencieuses, le mouvement léger des antennes toujours en quête, les pinces énormes, jetées devant comme des rames ou des crocs de boucher. C’est un vieux homard, vieux de quarante-deux ans ; il est rare qu’on en trouve de si vieux. Mais celui-là est immortel.
Elle referme les yeux. Machinale, sa main se porte à sa coiffure, de plus en plus défaite comme un écheveau emmêlé, pour y sentir la résistance légère du papier ; le billet est à sa place, dissimulé sous les boucles, la lettre de la reine qui est pour elle une charge de plus, une occasion porteuse de mort. Thérèse s’est laissé surprendre une fois encore. Seiffert a bien raison ; Thérèse est trop bonne. Mille fois, elle s’est perdue.
« Comment allez-vous, madame ? »
La princesse ne répond pas mais fixe à nouveau l’angle du mur et de la porte où, semble-t-il, l’image répugnante du homard a disparu. Comment va-t-elle ? Cette question. Comment va-t-elle. Elle en détache les syllabes une à une, puis les lettres. Elle les épelle. Les lettres, détachées comme les perles d’un collier, roulent et s’éparpillent dans sa mémoire, privées de sens et de lien car le fil est rompu.
« Je ne suis pas condamnée, murmure-t-elle. »
Mais c’est inutile. Illusoire. Les lettres roulent et s’éparpillent dans sa mémoire. Rien ne les arrêtera plus.
Par delà les portes et les grilles et sans discontinuer, proviennent des voix d’hommes, des éclats de colère ou des rires, des paroles monocordes qui égrènent des listes, d’interminables listes. On circule beaucoup ; parfois la mine d’un officier, d’un sans-culotte, vient s’encastrer dans les barreaux de la grille du judas et reluque, tantôt avec cette expression de patience cruelle, tantôt de ce regard qu’on porte sur les objets insignifiants dont l’existence soudain paraît aléatoire ou reléguée dans le passé. Ou bien c’est l’étonnement, les messes basses qui ne disent rien qui vaille, l’expectative. Et c’est peut-être pire. Une gardienne, solidement bâtie, rougeaude, aime à faire courir son bâton sur les barres métalliques, histoire de réveiller les dormeuses, de leur couper la route vers les rêves ; c’est une femme du peuple, une vachère vêtue de nippes, et à voir son air, une teigne. Mais ici, dans les couloirs de la Petite Force, les teigneux font la loi. N’importe qui fait la loi.
Thérèse refuse de telles pensées ; toujours elle s’est efforcée de croire que la méprise – oui, la méprise – était source de tout, que le peuple était bon, qu’en dépit de sa violence, de sa vulgarité, il méritait une attention égale, une constante charité. Hélas, aujourd’hui croire et penser deviennent inutiles et les idées s’effacent devant les choses ; et si Thérèse écarte ces pensées, c’est moins par grandeur d’âme que par effroi ; il est de ces réalités qu’on découvre soudain qui empêchent même de raisonner.
Ici, on les appelle les « putains royales ». C’est cela qui empêche de raisonner.