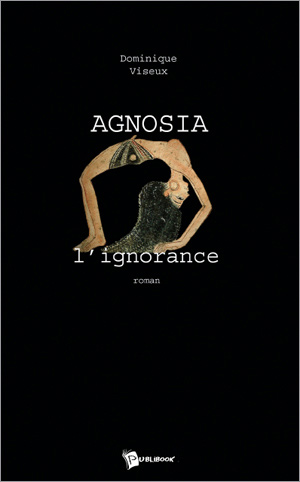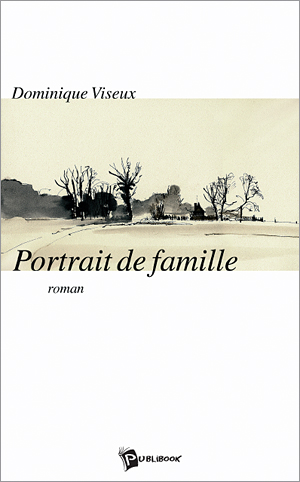Dans la paisible communauté de Siloès, connue et vénérée à cent lieues à la ronde, il s’éleva un jour un grand tumulte. Les frères ermites du désert — comme chaque matin après l’heure de la prière — descendaient le versant abrupt de la montagne pour se rendre dans la région des marais, laquelle, située en retrait du fleuve et généreusement irriguée, leur était réservée depuis plusieurs générations. Ainsi qu’à l’ordinaire, les frères de la communauté chantaient en chemin, frappant l’un contre l’autre des morceaux de bois au rythme de la marche et des psaumes entonnés, d’abord pour glorifier le Seigneur, ensuite pour annoncer en grand tapage leur présence et inviter hommes et bêtes imprudemment aventurés en ces lieux à déguerpir sans tarder.
Mais ce jour-là, une surprise les attendait. Ce fut le frère Nitras — en tête de la troupe — qui le premier s’arrêta net, leva en l’air ses bâtons et se mit à glapir les dernières syllabes du psaume comme s’il venait d’être mordu par un serpent. L’inquiétude flotta un instant sur le groupe et tous les yeux scrutèrent intensément les alentours dans le dessein de découvrir au plus vite la cause du mal étrange qui attaquait le frère Nitras.
La cause était assise là-bas, à moins de quarante pas, au milieu du marais, à l’endroit même où l’eau était claire et fluide comme une source vive ; la cause n’était ni plus ni moins qu’une créature du sexe honteux et, qui plus est, quasiment nue. Et cette cause, effrontément, insouciamment, outrageusement, se livrait à toutes sortes d’ablutions, buvait et souillait l’eau de la terre, empêchant Dieu comme le soleil de s’y mirer et, conséquemment, les frères de s’approcher.
La surprise générale céda bientôt le pas à l’indignation. Nombre de frères très vite détournèrent les yeux quand ils ne tournaient pas franchement le dos ; Antinoïs se mit à maugréer ; Théophraste pria ; Matios demeurait bouche bée comme un poisson sorti de 1’eau. Alors, faisant siffler sa baguette et battant le pan de sa tunique, Abba Philémon crut sage d’intervenir avec vigueur ; il dépassa le groupe de dix pas, puis, voyant qu’il pataugeait déjà dans l’eau souillée, se planta sur une motte de terre émergée et se mit à crier :
— Démon de femme ! Qui te donne le droit de salir ce qui est pur et de venir troubler le cœur des hommes qui cherchent Dieu ?
Elle sembla ne rien entendre ; sans sourciller, elle continua de boire — avec une impudence qui frisait la provocation —1’eau du marais. Peut-être était-elle sourde, tout simplement.
— Catin ! vociféra encore Abba Philémon. Si tu ne peux répondre, au moins va-t-en ! Retourne donc au diable qui t’envoie ! Nous saurons te chasser ! Fille de rien ! Prostituée ! Tu nous provoques impunément, fauteuse de mensonge et de péché !
Pas plus qu’à la première semonce, elle ne répondit. Plongeant ses longues et fines mains dans l’eau, elle but encore avec un calme identique, une même dévotion — aurait-on dit. Dévotion feinte, pensa Philémon, toujours faisant siffler sa baguette en roseau. Il se tourna furieux vers le groupe muet.
— Matios ! appela-t-il.
Matios s’approcha prudemment, les yeux fixés sur le sol boueux comme s’il craignait de s’enliser.
— Matios, gronda Abba Philémon quand le frère l’eut rejoint, toi qui es sans faiblesse, rends-toi auprès de cette créature de Satan et fais ce qu’il convient de faire pour qu’elle s’en aille.
— Abba, répondit Matios en gémissant et tournant sur lui-même sans jeter un regard alentour, tu ne peux me commander telle chose. Dix ans ! Il me faudra dix ans ensuite pour que de mon esprit s’en aille l’image de cette femme. Demande à Josephe. Lui, il sait…
Abba Philémon le repoussa, scrutant d’un œil mauvais l’infernale créature qui prenait ses aises et dévoilait ses charmes pour narguer de sa présence toute la communauté ; alors il appela à lui Josephe, lequel à son tour s’approcha. Vêtu d’un simple pagne, il était le plus jeune des anciens, mais certainement aussi l’un des plus courageux.
— Josephe, lui dit Philémon, tu es agile et vigoureux. Prends cette baguette et chasse cet objet de honte comme tu le peux. Je compte sur toi. Si tu échoues, la honte tombera sur la communauté. On se moquera de nous.
Voyant l’irritation du vieillard, Josephe s’empara de la baguette de roseau et s’avança dans l’eau. Lorsqu’il fut tout proche de la créature, maintenant immobile et le visage penché sur l’eau, il s’arrêta pour la contempler. Ses cheveux longs et sales couvraient ses épaules ; sa peau semblait rugueuse et cuite par le soleil ; elle était femme, assurément, mais si émaciée qu’il eût dit un insecte. Il attendit. Alors elle releva son visage vers lui.
— Tu viens pour me frapper, Josephe ? demanda-t-elle.
Aucune expression ne marquait son visage qui surprit Josephe par sa quiétude et la régularité de ses traits. De son regard seules émanaient une brillance et une intensité.
— Que cherches-tu ? demanda-t-il sans se montrer sévère.
— Je cherche Dieu, répondit-elle sans se troubler.
— Dans l’eau ? s’étonna Josephe.
— L’eau est le plus limpide des miroirs de Dieu, rétorqua-t-elle. Pourquoi ne le chercherais-je pas dans l’eau ?
— Tu sais que cet endroit est réservé aux frères de Siloès, reprit Josephe avec douceur. Pourquoi viens-tu nous provoquer ?
Lentement elle sortit de l’eau ses longues mains qu’elle prit soin d’égoutter puis, à la seule force de ses cuisses d’où l’on voyait saillir les muscles, elle se dressa. Dans sa lenteur, Josephe discerna de la noblesse, du détachement. Alors il prit le temps de 1’observer et put voir qu’un rien l’habillait : seul un pagne de lin dérobait à la vue son bas-ventre. Avec des gestes délicats, elle ramena quelques mèches de sa chevelure pour couvrir sa poitrine aux seins inexistants. Enfin elle répondit :
— Le sens que l’on accorde aux choses dépend du regard que 1’on porte sur elles. Pourquoi dis-tu que je viens dans le dessein de vous provoquer, lorsque tout simplement je me désaltère et goûte à la fraîcheur de l’eau ?
— Tu parles bien, rétorqua Josephe, fronçant les sourcils et remuant sa baguette. Mais je ne sais toujours pas qui tu es ni quel est ton dessein.
— Je te l’ai dit, mon frère, reprit-elle. Toi qui cherches Dieu, comment le trouveras-tu si tu ne sais immédiatement discerner le vrai du faux ?
— Le faux se cache toujours derrière le vrai, dit Josephe.
— Alors frappe-moi ! déclara-t-elle soudain sur le ton du défi ; car même si j’ai dit vrai, le faux se cache derrière moi.
Josephe eut un bref sourire. Il hésita. Enfin il leva sa baguette et lui cingla les cuisses. Son corps tout entier fut parcouru d’un tressaillement. Son visage pourtant garda toute sa quiétude. Il sembla même que la douleur, au lieu de cuire, produisait en son être une ivresse proche de la béatitude.
— Tu vois, dit-elle sans que l’on pût soupçonner dans sa voix un effort, malgré le faux, le vrai résiste. Sans doute ai-je réussi à les concilier.
— Soit, admit Josephe. Dis-moi alors ce que tu fais ici.
Elle détourna les yeux vers la communauté qui attendait, pareille à un cortège d’effigies funéraires, puis son regard s’éloigna vers le sommet bleuté des montagnes.
— Je viens des hautes Terres, dit-elle enfin. J’y ai passé trois années dans la plus absolue des solitudes. Vois, le désert m’a brûlée. J’y cherchais Dieu. Je crois l’avoir trouvé. Ou j’ai trouvé son ombre. Hélas, depuis l’arrivée des barbares, les caravanes des marchands longent le fleuve par l’autre rive ; à tout moment, je crains d’être surprise. La mort ne m’effraie pas, mon frère ; mais je 1’avoue, l’idée de tomber en servitude me fait fuir. Sans doute est-ce là la part de Dieu qui m’échappe toujours.
— Qui donc voudrait de toi ? plaisanta Josephe. Tu es fragile comme un criquet. Tu n’as ni seins ni ventre, et moins de fesses encore.
Elle se mit à sourire.
— Néanmoins ce qui reste suffit à mettre la déroute dans ta communauté. Regarde-les. On les croirait surpris dans les charmes de Satan.
Josephe se retourna, contempla un instant la troupe des frères en alerte, puis se ressaisissant, releva sa baguette et de nouveau cingla l’intruse en plein visage. Elle accusa le coup mais, comme précédemment, se détendit et laissa la douleur l’envahir.
— Tu n’as toujours pas répondu à ma question, insista Josephe. Que fais-tu donc ici ? Dans ce marais qui nous est réservé ?
— Ô, mon frère, répondit-elle d’une voix mi-plaintive mi-extasiée, frappe-moi ; frappe-moi encore. Tes coups sont des caresses. Ta brûlure est comme un feu qui me dévore.
Josephe s’impatienta.
— Me répondras-tu ? gronda-t-il.
Elle le contempla avec fixité.
— A toi, je dirai tout, annonça-t-elle. Je vis depuis moins d’une lune au-delà des montagnes. Dans la vallée des Morts, c’est là que j’ai trouvé refuge. Souvent je gravis le sommet et je vous vois de loin. Vous observer m’amuse. La nuit, en secret, je descends au marais pour me désaltérer, cueillir les herbes qui me nourrissent. Mais cette nuit, vois-tu, j’ai refusé cette existence de bête apeurée, et j’ai compris que Dieu m’ouvrait la voie du jour et du courage de paraître. Je suis nouvelle et renée de moi-même. Je ne crains plus les hommes.
— Mais tu crains la servitude. Comment te nommes-tu ?
— Toi d’abord. Dis-moi ce que tu cherches ?
— Je m’appelle Josephe. Je cherche la connaissance.
— Je suis Agnosia, l’ignorance.
Josephe, de surprise, se remit à sourire. Relevant sa baguette, il la menaça en criant :
— Alors va-t-en d’ici ! Ne reviens plus !
Elle s’écarta d’un bond.
— Je reviendrai demain, Josephe. Pour toi, rien que pour toi. J’aime tes coups qui me cinglent le cœur.
Enfin elle prit la fuite et disparut derrière un bosquet de roseaux…